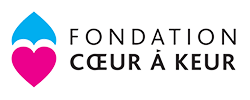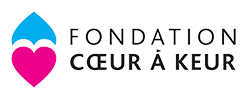- fondationcoeurakeur@gmail.com
- Cotonou, Camp Guezo, Rue 5100
Enfants en conflit avec la loi : la justice juvénile béninoise face à ses limites
Au Bénin, les enfants arrêtés sont souvent plus victimes que coupables d’un système juvénile à bout de souffle. 95 % des mineurs incarcérés sont des garçons, et 97 % de ces enfants sont en détention provisoire, bien que la législation exige la priorité de mesures extrajudiciaires. Les données de 2023 à la Maison d’arrêt de Cotonou révèlent que 2,24 % des détenus pour délits sont des mineurs.
Ces jeunes viennent majoritairement de milieux défavorisés, souvent déscolarisés ou issus de familles monoparentales. Beaucoup n’ont même pas terminé l’école primaire. Ils vivent dans des contextes marqués par la violence familiale, l’alcoolisme, la pauvreté, qui exposent les enfants à des comportements irréguliers dès le plus jeune âge.
Psychologiquement, l’incarcération précoce génère l’anxiété, la dépression, les troubles du comportement et entrave la construction de leur identité. La spirale de la délinquance, bien documentée en criminologie, montre comment un environnement toxique et la fréquentation de pairs déviants nourrissent la récidive.
Cadre légal, des lois innovantes, pratique en panne…
Le cadre légal béninois en justice juvénile s’est enrichi avec l’ordonnance de 1969, la ratification de la CDE, les chartes africaines, la réforme en 2019 pour renforcer les alternatives à l’incarcération. Le manque de structures adaptées, de formation des acteurs et de moyens financiers compromet l’application de ces lois.
Le programme Enfance sans Barreaux promeut une justice réparatrice, axée sur la médiation et les alternatives à la détention. À Cotonou, un séminaire en septembre dernier a rassemblé magistrats et ONG pour diffuser des pratiques de médiation pénale et familiale. La Brigade de Protection des Mineurs, créée en 1983, reste l’unique service spécialisé, mais manque souvent d’effectifs et de moyens pour agir efficacement.
L’UNICEF rappelle l’impératif de la séparation enfants/adultes en garde à vue et encourage les mesures alternatives. Selon une psychosociologue de référence, la justice doit s’appuyer sur les liens sociaux, désamorcer l’exclusion et intégrer l’environnement familial et communautaire. L’approche réparatrice une reconstruction plus solide.
Conséquences humaines et sociales…
Comme conséquences, l’on peut noter, l’interruption de l’éducation, car l’incarcération prive les enfants de scolarité, limitant leurs chances d’insertion future. L’on enregistre les cas de récidive sans soutien ni accompagnement, la plupart retombent dans le délit, souvent aggravés par l’enfermement.
Il y a aussi l’impact familial dû à la séparation entraînant une rupture affective, la stigmatisation sociale et l’affaiblissement des structures parentales. Malheureusement, certains freins résistent à la réforme à l’instar des ressources humaines insuffisantes dont les juges, les éducateurs et les agents sociaux spécialisés qui sont encore trop rares.
À cela s’ajoute, les infrastructures manquantes, notamment peu de centres adaptés, le surpeuplement des prisons, l’absence de suivi post-détention, un financement en baisse et une absence de mesures alternatives.
Vers une réponse rénovée…
Afin d’y faire face, il urge de renforcer les alternatives à l’incarcération, de développer le travail d’intérêt général supervisé, d’élargir la médiation éducative et familiale, de former et de mobiliser les acteurs, d’instituer une formation continue spécialisée pour les juges, les éducateurs et policiers, de créer des guides pratiques pour la police et la justice, de mettre l’accent sur le suivi post-détention, d’offrir un accompagnement psychosocial, de scolarité, d’insertion et de mentorat, mais aussi s’appuyer sur l’approche résilience impliquant les familles dans le processus réparateur.
Défis à relever…
Pour relever les défis, il faut sortir de l’approche punitive et installer une justice réellement réparatrice, alliant médiation, éducation, suivi psychosocial, participation communautaire et investissement durable.
Ce pari nécessite une volonté politique à la hauteur des droits de l’enfant, mais surtout une vision collective, celle d’offrir à chaque enfant placé en conflit avec la loi non une fin, mais une seconde chance pour qu’il devienne acteur de sa propre réinsertion et citoyen épanoui de demain.