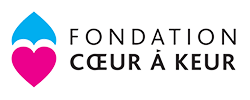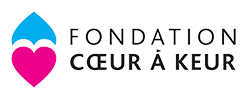- fondationcoeurakeur@gmail.com
- Cotonou, Camp Guezo, Rue 5100
Réforme de la justice des mineurs au bénin:entre progrès et défis
Des avancées concrètes….
Les statistiques de la délinquance juvénile…
Réhabilitation ou récidive ?
Le cas de Koffi, 16 ans, illustre la complexité du processus de réhabilitation. Accusé de vol à main armée dans un marché à Cotonou, il a été placé en détention au centre de Missérété. Après six mois de prise en charge, Koffi a montré des signes d’amélioration, mais une fois libéré, il est retombé dans la délinquance.
Ce cas soulève la question de l’efficacité des mesures éducatives après la sortie des centres de rééducation. Le manque de suivi post-incarcération et les difficultés d’insertion dans la société restent des points d’interrogation. À l’inverse, le cas d’Aminata, 14 ans, condamnée aussi pour vol, illustre les possibilités offertes par une prise en charge éducative adaptée.
Placée dans un centre de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence après son jugement, Aminata a suivi un programme scolaire. Un an après sa libération, elle est parvenue à réintégrer le système scolaire et à trouver un emploi stable dans un atelier de couture à Parakou. Son histoire démontre que, malgré les obstacles, des parcours de réinsertion réussis sont possibles.
Vers une approche globale et plus humanitaire…
Afin de renforcer l’efficacité de la justice des mineurs, plusieurs pistes doivent être explorées. Il s’agit notamment du renforcement des moyens financiers et humains, du suivi post-libération, de la construction d’infrastructures adaptées et de la mise en place de politiques sociales de prévention à travers des programmes de soutien aux familles vulnérables.
La justice des mineurs au Bénin continue de se transformer dans un contexte où la répression des actes délictueux doit se marier avec la nécessité de réinsertion sociale. Si des progrès sont réalisés, en l’occurrence à travers les réformes législatives et les efforts de prise en charge éducative, la mise en œuvre effective de ces mesures sur le terrain reste complexe.
Le défi demeure d’assurer que les jeunes délinquants aient véritablement une chance de réintégration et que la société béninoise puisse offrir un meilleur avenir aux générations futures.